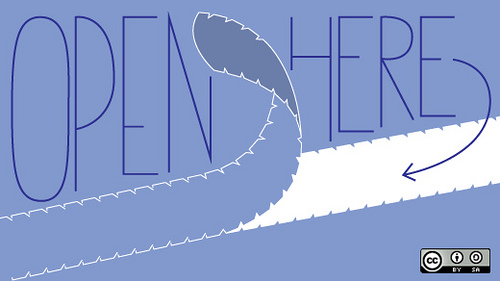 Dans un climat économique difficile, déterminer la valeur d’une bibliothèque de recherche et celle d’une IST, sa matière première, devient une question cruciale. Le Congrès 2014 de l’ADBU [1] s’y est penché.
Dans un climat économique difficile, déterminer la valeur d’une bibliothèque de recherche et celle d’une IST, sa matière première, devient une question cruciale. Le Congrès 2014 de l’ADBU [1] s’y est penché.
Pour cerner le sujet, un peu de théorie (une approche économique puis normative), de pratique (retours de deux études britanniques et d’une étude espagnole) et une projection à l’échelon politique et stratégique. La question est loin, en effet, d’être anodine.
Quelques points retenus, parmi bien d’autres, la plupart des interventions étant disponibles en ligne.
Déterminer la valeur des bibliothèques
Que l’IST ait une valeur, on en convient facilement. Mais une bibliothèque de recherche ? S’en passer, dans l’environnement numérique et dans un contexte budgétaire préoccupant ? Si on pressent que les bibliothèques restent utiles, encore faut-il le prouver. Mais comment mesurer leur valeur économique et sociale ?
Mener des études. Les études sur ce sujet sont rares (hors des pays anglo-saxons, et encore…) et la question est complexe. Elle n’en reste pas moins critique – des comptes à rendre – et il faut s’y atteler. De quoi disposerait-on ?
Études d’impact, études coûts/bénéfices, voilà deux types d’études où ce qui est quantitatif (données démographique des usagers, salaires du personnel, coût des acquisitions, bénéfices de produits et services payants [2], etc.) semble facile à cerner. Encore faut-il ne rien oublier d’essentiel, et s’intéresser aux coûts et aux bénéfices induits sans surévaluer ni sous-évaluer leur poids. Quant à l’approche qualitative, elle permet d’aborder des concepts intéressants comme les valeurs de non-usage que sont la valeur d’option (« j’irai peut-être un jour »), d’existence (« je n’irai pas mais j’accepte de payer pour ce qu’elle représente ») ou de transmission (la conservation du patrimoine) que peut avoir une bibliothèque, son rayonnement sur le territoire et au-delà,… Le « geste architectural » qu’est la bibliothèque de Lausanne, par exemple, n’a-t-il pas aussi un impact sur sa ville et sa région, d’une autre nature, certes, mais bien au-delà de ses seuls chercheurs et étudiants ?
Au-delà du gain de temps pour la recherche d’information, du taux de réussite aux examens, une bibliothèque n’a-t-elle pas un impact en termes d’acquisition de compétences (maîtrise des TICE, par exemple), d’insertion dans le monde du travail, d’attractivité pour des étudiants et des chercheurs (de qualité), voire d’entreprises, et par la-même de subventions pour le centre de recherche de l’institution ? L’étude faite par l’Université de Manchester mettait l’accent sur 10 types de valeurs.
Quatre unités de bénéfice pour une unité investie, a-t-on relevé dans une enquête. Un bon score mais, comme toutes les enquêtes, des précautions seront prises pour le choix des indicateurs, dans les corrélations qui sont faites, et dans les conclusions tirées des résultats susceptibles, en outre, de varier selon les disciplines, les pays, etc.. Enquête statistiques, d’observation, de satisfaction,… Des questionnaires divers et, parmi les questions, des questions implacables – « qui pour remplacer les services de la bibliothèque ? » ou encore « qu’accepteriez-vous de payer pour ce service » ? - propres à souligner leur vraie valeur. Alors, certes, les méthodologies semblent quelquefois encore « fragiles », mais n’a-t-on pas affirmé aussi, lors de la conférence, que les économistes savaient quantifier des éléments qualitatifs ? Des travaux à poursuivre et nul doute, que la norme ISO 16439 sur les méthodes et procédures pour évaluer les bibliothèques, adoptée en 2014, sera d’un grand secours.
Un facteur d’impact pour les bibliothèques ? La question est délicate lorsqu’on connait les biais existants en matière de revues [3] et que le classement de Shanghai fait l’objet de critiques. Quelle aune, en effet, adopter ? Disposer d’indicateurs, savoir les interpréter, disposer de guides,… Oui, mais diffuser des classements selon les performances de chacune ?
Retours d’expérience. Prouver que l’on est satisfait des services d’une bibliothèque est une chose, prouver qu’ils ont un impact sur la recherche est indéniablement plus complexe. C’est ce qu’on retiendra d’une étude sérieuse menée, avec beaucoup de recul sur les résultats, par l’Université de Manchester. La présentation relevait la nécessité de corréler études qualitatives et quantitatives afin d’obtenir « des résultats structurants et consistants » démontrant que la bibliothèque « fait ce personne ne fait ni ne fera ». « L’argent suivra », fut-il souligné aussi, si on s’aligne sur la stratégie de l’établissement et des chercheurs et si on parvient « à apporter l’intelligence » dans la bibliothèque (ou tout simplement à le faire savoir, car, bien souvent, me semble-t-il, elle s’y trouve déjà).
Présenter l’étude de l’Université de Huddersfield [4] (Yorshire) sur l’impact des services documentaires sur les résultats des étudiants a mis en évidence plusieurs outils d’analyse et de visualisation des activités d’une bibliothèque et les précautions à prendre dans l’analyse des résultats. L’étude sur la valeur économique et sociale de l’ensemble des bibliothèques et centres de documention en Espagne [5] donne des taux de retour sur investissements, les résultats d’études de satisfaction des services, l’opinion des non-usagers sur le rôle joué par les bibliothèques, etc. et, parmi les apports, le gain de temps pour la recherche de documents, y compris grâce aux sites web, le fait d’être un lieu idéal pour étudier, ou encore l’impact (attendu) en termes de culture, ou encore pour l’environnement,etc., soit autant d’indicateurs positifs.
On regrettera alors que la contribution de la documentation, si souvent reconnue dans les enquêtes, ne semblent pas l’être dans les appels d’offre. Voici une piste, parmi bien d’autres, qui contribuerait à améliorer leur visibilité et leur rôle [6].
Ouvrir l’information scientifique
« Rompre le silence ». Que la science soit ouverte, il est de bon ton d’en convenir. Mais l’ouverture se traduit différemment dans un monde où la propriété intellectuelle s’invite. Quel équilibre définir alors, sachant que l’ouverture a un impact positif sur bien des points et à long terme, que les licences des éditeurs représentent souvent des obstacles, que le text mining, essentiel pour la recherche, doit bénéficier d’une exception, que les licences nationales – une avancée-, restent nationales alors que la stratégie doit se définir au niveau international, etc. ? Ces dossiers, parmi d’autres, partagés par les bibliothèques, font partie de la feuille de route de la Ligue européenne des établissements de rercherche (Leru), qui entend mobiliser la France – et d’autres pays – autour de l’exception pour le Text Mining, ce que vient d’accorder le Royaume-Uni, donner son avis sur la Science 2.0 à la Commission européenne, etc. Un travail que chercheurs et bibliothèques vont mener en commun.
« Ne pas être naïfs ». Pour Mme Trautmann, ouvrir l’IST implique une réflexion globale préalable sur l’ensemble des questions numériques, une régulation de la chaîne de valeur (coûts des services d’accès, valeur ajoutée, risques de monopoles,…), une réponse à des objectifs de sécurité et de défense, une bataille pour des valeurs comme hier pour la diversité culturelle, … ce qui se traduit par une hiérarchie à définir entre propriété intellectuelle, technologies de la communication et de l’information, gouvernance de l’Internet, protection des données personnelles, etc. Au-delà du seul échanges de biens et services, il est fondamental d’avoir une vision européenne commune pour faire poids face notamment aux États-Unis. L’ouverture ne doit pas se faire tous azimuts et n’importe comment.
« Construire un droit de la science ouverte ». C’est l’exhortation faite à la communauté scientifique par Me Bensoussan [7]. Dans un avenir constitué uniquement de plateformes et où les bibliothèques auront disparu, le risque est grand d’être tributaire des conditions d’utilisation définies, comme le font aujourd’hui FaceBook et d’autres, par chacune d’entre elles. Lois, éthique, contrats, aucune des trois solutions ne répond aux impératifs de l’ouverture de la science, un droit naturel, principe universel, donc en amont des droits légaux. Et de prôner à la communauté scientifique de créer, « sans les juristes et sans les États-Unis », une science ouverte sur le plan juridique, fondée sur un droit naturel, qui ne serait pas « un strapontin du droit d’auteur », qui serait indépendante du concept de plateforme, du Green et du Gold, etc. Mais la stratégie étant « audacieuse, on risque fort de se contenter d’une « licence Open Science » où données en amont de l’article et données en aval ne sont pas privatisée seraient gérées par une agence. À creuser… Vite.
Un monde décloisonné et ouvert génère de la valeur. C’est ainsi que je résumerais l’exposé conclusif, qui ouvrait bien des perspectives, de Christophe Péralès, président de l’ADBU.
Ill. Open source Libby Levi Flickr CC BY SA
Notes.
[1] ADBU : Association des Directeurs et personnels de direction des Bibliothèques universitaires et de la documentation.
[2] Une édition, mais aussi une exposition, par exemple, ou diverses utilisations des locaux adoptées davantage dans les pays anglo-saxons.
[3] Le facteur d’impact des revues, un indicateur à manier avec prudence, Ojasoo Tiiu, Marc Maisonneuve, Yves Matillon, La presse médicale, n° 2002, n°17.
[4] The impact of library usage : from research project to development of a shared libray analytics service for UK academic libraries, Graham Stone, 2014
[5] The Economic and Social value of Information services libraries, Fesabid, 2014.
[6] Les bibliothèques apparaissent à peine dans une étude sur l’apport de la culture à l’économique française menée récemment à l’initiative du ministère de la Culture. Les bibliothèques universitaires encore moins, car dépendant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, démontrant, si besoin était, la nécessité de décloisonner le champ des études.





