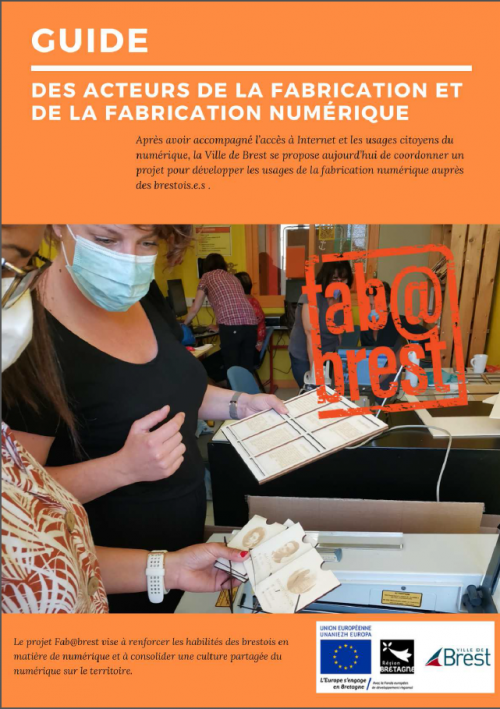On sait :
- ce qu’ils sont : "Un site de réseau social est une catégorie de site web avec des profils d’utilisateurs, des commentaires publics semi-persistants sur chaque profil, et un réseau social public naviguable ("traversable") affiché en lien direct avec chaque profil individuel." (Danah Boyd)
- que 2003 est la date clé de l’explosion de ces réseaux avec le lancement (entre autres) de MySpace, Friendster et LinkedIn (même si dès 1988 AOL disposait déjà de la notion de "profils publics" accessibles selon différents centres d’intérêt) (Via le Wiki Public de Danah Boyd sur l’histoire et la constitution des réseaux sociaux)
- que les jeunes en raffolent. D’après une récente étude, "96 % des adolescents américains participent à un réseau social au moins une fois au cours d’une semaine. Les filles y seraient d’ailleurs plus nombreuses que les garçons." (Via Technaute)
- qu’ils reproduisent les schémas sociaux habituels. A chaque "classe" son réseau social. tels les Jets et les Sharks de WestSide Story, des réseaux sociaux initialement "élitistes" (Facebook était au départ destiné aux étudiants de Harvard) "recrutent naturellement" du côté des classes moyennes et au-delà, pendant que MySpace tant sur la forme (l’habillage du site) que sur le fond (son public) agrège naturellement un public plus "underground", moins "bourgeois", plus "large" et plus "jeune". (Via InternetActu se faisant l’écho de cette étude de Danah Boyd). En complément, ce serait près de 85% des tennagers qui seraient inscrits sur MySPace contre seulement 7% sur Facebook. (Via ZDNet)
- que les gens participent peu. Plus exactement que très peu de gens participent beaucoup et que beaucoup de gens participent très peu. Comment le sait-on ? (Via Le Semeur) en croisant le fait que 35% des internautes américains publient des contenus en ligne avec la règle des 1% (2/3 des contenus produits proviennent de 1% des utilisateurs actifs). Dès lors, l’échelle de participation globale de l’ensemble des réseaux sociaux disponibles est probablement déployée sur le modèle de la longue traîne, avec énormément de participants "étalés" en fin de traîne, dans des réseaux sociaux "de niche".
pour une sériation plus fine selon l’âge et le type d’activité, voir ce billet d’InternetActu)
- que la monétisation des services est leur modèle économique. (Via Toile-Filante) Beaucoup d’entre eux proposent un modèle d’intéressement aux acteurs, via différentes modalités de rétribution financière, et ce quel que soit le "coeur de média" (vidéo, son, image, "contacts" ...) du réseau concerné. Parmi les principaux modèles de rétribution on citera :
- celui, bottom-up, de la prime à l’accès, ou de la prime au vote : vous touchez de l’argent si votre média (texte, article, vidéo, photo, etc) arrive en page d’accueil du site ou est parmi les plus téléchargés/accédés/votés. Le modèle du genre et le plus emblématique est YouTube qui "a décidé de partager ses recettes publicitaires avec les “top users” sélectionnés dans la liste “most subscribed”." (Via Martin Lessard)
- celui, top-down, du reversement par le site "hôte" d’une partie des gains générés via une régie de type "Google Adsense".
- celui, "middle-middle" (??) qui propose une rémunération moins importante à plus de monde via un certain nombre de palliers
- celui enfin, beaucoup plus classique et éditorialisé du "pigiste-citoyen", tel CitizenBay ou OhMyNews : vous écrivez un article, soumettez une "news" et si elle est sélectionnée, vous êtes payé.
- qu’il faut distinguer entre réseaux généralistes et réseaux spécialisés. Le site Techcrunch en propose la définition suivante : "un réseau social généraliste a pour première vocation de rester en contact, un réseau social spécialisé repose sur un intérêt commun." On pourrait donc ici calquer sur cette analyse la dichotomie souvent présente au coeur des pratiques de gestion de la connaissance (Knowledge Management) distinguant entre communauté de pratique (réseaux spécialisés tels LibraryThing) et communauté d’intérêt (réseaux généralistes). Et que les réseaux spécialisés peuvent eux-mêmes êtres scindés entre réseaux sociaux spécialisés "à large spectre" (LibraryThing) et réseaux spécialisés "de niche". Sur ces derniers, voir notamment l’ensemble des billets de Fred Cavazza sur la question.
- Que côté chiffres, "MySpace demeure le leader avec quelques 180 millions d’utilisateurs, là où FaceBook n’arriverait pour l’instant qu’à une quarantaine." (Via InternetActu), mais que FaceBook suit une courbe de progression non seulement exponentielle mais également intéressante du point de vue de la captation de nouveaux publics.
* Qu’il y a probablement quelque chose de culturel dans leur logique de déploiement et d’adoption à l’échelle de la planète connectée, comme le montre cette carte. (Via Francis Pisani) [1]
- Que la privauté de ces espaces publics ou semi-publics pose problème. Comme l’analyse Danah Boyd (encore ...) dans cet article (.pdf), 4 paramètres contribuent particulièrement à la confusion entre espace public et espace privé :
- la persistance : ce que vous dîtes à 15 ans sera encore accessible quand vous en aurez 30 ...
— * la "searchability" (littéralement, capacité à être recherche/retrouvé) : avant les réseaux sociaux, votre mère ne pouvait pas savoir où vous étiez en train de faire la fête avec vos amis ou ce que vous pensiez d’elle. Maintenant ... c’est possible.
— * la "reproductibilité" : ce que vous avez dit/publié/posté/photographié/filmé peut être recopié et replacé dans un univers de discours totalement différent. - les "audiences invisibles" : la médiation particulière que constituent ces réseaux sociaux et la conjugaison des trois critères précédemment cités fait que la majorité des publics/destinataires est absente au moment même de la médiation (= la transmission du message = par exemple, la publication d’un message texte),créant ainsi un effet non pas simplement de voyeurisme mais une temporalité numérique particulière.
- la persistance : ce que vous dîtes à 15 ans sera encore accessible quand vous en aurez 30 ...
- que le paradoxe des "réseaux sociaux privés" (en gros : on utilise des réseaux sociaux en y déversant avec impudeur nombre de données très personnelles et on réclame en même temps un droit à une "privauté" qui apparaît comme nécessairement antagoniste ou contradictoire avec la nature du service offert.) peut pour une bonne part s’expliquer par les 4 critères listés précédemment. Et pour faire plaisir à Manuel Z. (du collectif des opposants à l’identité numérique ;-), je crois que la problématisation liée à l’illusion de privauté des espaces numériques publics ou semi-publics est effectivement plus riche que celle de la "simple" identité numérique.
- qu’ils constituent un écosystème de recommandations croisées nécessaire au développement pérenne d’une économie de l’accès. A moyen terme, ces réseaux sociaux pourraient n’être que le premier étage, la base de plus en plus large et stratifiée d’une économie globale de l’attention ou de l’accès, laquelle ne pourra parvenir à monétiser confortablement l’ensemble des services lancés qu’au prix d’un maillage suffisant de ce premier étage, celui d’un écosystème de recommandations croisées. En d’autres termes, (la stratégie de) l’adressage - au sens littéral des carnets d’adresse que permettent de partager nombre de réseaux sociaux - est la clé (de l’économie) de l’accès.
Et puis surtout, grâce à cette carte, on sait où ils sont ;-) (Via Serial Mapper)
Comment cela ? Vous en voulez encore ?!??
Je vous conseille également l’ouvrage su sociologue Pierre Mercklé, Sociologie des réseaux sociaux, qui date un peu (2004) mais permet de bien resituer d’importantes problématiques avec comme horizon d’analyse le débat concernant le fait que ces réseaux sociaux pourraient constituer, ou non, "un nouveau paradigme sociologique, une « troisième voie » théorique entre le holisme et l’individidualisme sociologique."
Il me semble aujourd’hui en tout cas incontestable que l’essor et les modalités de déploiement et d’adoption de ces réseaux attestent que la prochaine grande collection documentaire vécue comme utopie motrice, sera celle de la collection des individualités humaines. Et que face à cet enjeu, les sciences de l’information et de la communication d’une part, et la sociologie et la psychologie sociale d’autre part, ont entre leurs mains de bien beaux terrains d’analyse.
Il faudra également faire preuve de vigilance si l’on ne veut pas que l’explosion sociologiquement passionnante des usages du "Lifelogging" (le lifelogging désigne "notre intimité augmentée d’information : ce sont là nos objets et nos actions qui sont enregistrés, disponibles et qu’on peut analyser et monitorer à distance") ne bascule pas dangeureusement vers un "lifemarketing" ou un "lifeprofiling" reposant entre les mains de quelques multinationales.
04 juil. 2007