La réponse est : plus tard qu’on ne le croit…
Si les premières lois sur le droit d’auteur ou le copyright remontent au XVIIIe siècle, elles ne s’appliquaient pas uniformément à tous les textes. Les articles des revues périodiques sont restés longtemps un cas à part : ils appartiennent d’abord à un domaine public de facto (la jurisprudence ne parvenant pas à établir leur appartenance au régime général du droit d’auteur) ; à partir des années 1850, les traités internationaux de protection littéraire prévoient une licence libre par défaut (tous les articles de revues peuvent être reproduits, sans l’accord de l’auteur, sous réserve d’être cités).
Ces exceptions ne commencent à disparaître qu’en 1908 lorsque le congrès de Berlin établit que les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques publiés dans les “recueils périodiques d’un des pays de l’Union, ne peuvent être reproduits dans les autres pays sans le consentement des auteurs.” La disposition acte un processus définitif de normalisation, qui s’actualisera un peu plus tard : tous les pays signataires de la convention de Berne n’adoptent pas cette nouvelle mouture ; et, surtout, les revues scientifiques ne modifient pas immédiatement des pratiques anciennes (dans certaines disciplines, elles survivent encore aujourd’hui).
Ce pan de l’histoire des communs scientifiques a été très largement oublié : je n’ai pas trouvé d’études ou de sources secondaires qui lui soit consacré. Et pourtant, alors que le mouvement open access prend de l’ampleur et que l’on parle sérieusement de le consacrer par une loi, la redécouverte de ce passé relativement récent constitue une contribution importante au débat public. Savoir, par exemple, que de 1852 à 1908, la France et la plupart des pays européens mettaient déjà en œuvre, dans leur traités bilatéraux, une politique de “libre accès”, en édictant par défaut une licence assez proche de la licence CC-BY, montre que l’ouverture des publications scientifiques n’est pas une nouvelle lubie née de l’essor du web, mais, bel et bien, une aspiration fondamentale des communautés universitaires et intellectuelles.
Un domaine public de facto (1710-1852)
Les premières lois sur le droit de copie ou le droit d’auteur reposent une présupposé inavoué : elles n’ont été explicitement conçues que pour certaines formes de publications, les créations artistiques et littéraires. Le Statut de la Reine Anne de 1710 ne parle ainsi quasiment que de “books” et de “bookseller”. Le dispositif de dépôt légal de la loi française du 24 juillet 1793 s’adresse à “tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage,
soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit” (art. 6).
Et pourtant, ces dispositions fondatrices ménagent une extension possible. La loi française de 24 juillet 1793 vise ainsi les “auteurs d’écrits en tout genre, les compositeurs
de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux et dessins” (art. 1er). Jusqu’où s’étendent les “écrits en tout genre” ? La question a occupé des générations de juristes, avant que l’interprétation maximaliste ne finisse par l’emporter au cours du XXe siècle.
Ce cadre légal répond aux attentes des industries culturelles : les grands éditeurs parviennent alors à rétablir des formes de contrôles monopolistiques alors très critiquées, voir suspendues (pendant vingt ans, de 1692 à 1710 le Royaume-Uni expérimente une période de dérégulation totale ; au début des années 1790, un projet de Sieyès prévoyait une durée de protection très courte (quelques années)). La plupart des auteurs n’en retirent qu’une rétribution matérielle très faible ; ils obtiennent cependant une forme de reconnaissance symbolique de leur statut d’auteur (ce que Michel Foucault appelle une fonction auteur). Les compositeurs de musique se sont ainsi mobilisés, sous l’impulsion du fils de Jean-Sébastien Bach, Jean-Chrétien Bach, pour étendre le Statut de la Reine Ann aux partitions1 .
À côté des industries culturelles, il existait d’autres cultures textuelles, qui ne partageaient nécessairement les mêmes aspirations. La figure de l’auteur est totalement absente de la presse généraliste. Les articles ne sont quasiment jamais signés et l’emprunt, d’un journal à l’autre, est un procédé systématique. Le tout premier quotidien, publiait ainsi une collection de dépêches et de lettres collectées un peu partout. Le grand spécialiste de la propriété littéraire française du premier XIXe siècle, Renouard, désespère ainsi d’intégrer le journal au cadre général du droit d’auteur :
En droit, cette question ne peut pas être douteuse ; aucune loi, aucun motif raisonnable n’excluent les écrits insérés dans les journaux des garanties assurées à tous les genres d’écrits. En fait et dans l’usage, cette question, si simple, par elle-même, s’obscurcit et se complique. Une habitude d’emprunts réciproques entre les feuilles périodiques s’est établie par la force des choses et s’exerce avec une latitude qui dégénère en abus. Ce n’est pas seulement la réciprocité de copie qui explique cette tolérance, c’est aussi la communauté, en même temps que la variété des sources auxquelles la rédaction des journaux est ordinairement puisée2 .
Le modèle économique de certains journaux repose exclusivement (et explicitement) sur la reprise et la compilation d’articles publiés ailleurs. J’ai ainsi débusqué sur Gallica une publication extraordinaire du début des années 1830 (soit à une époque où le droit d’auteur est en vigueur depuis quarante ans) : le Pirate.
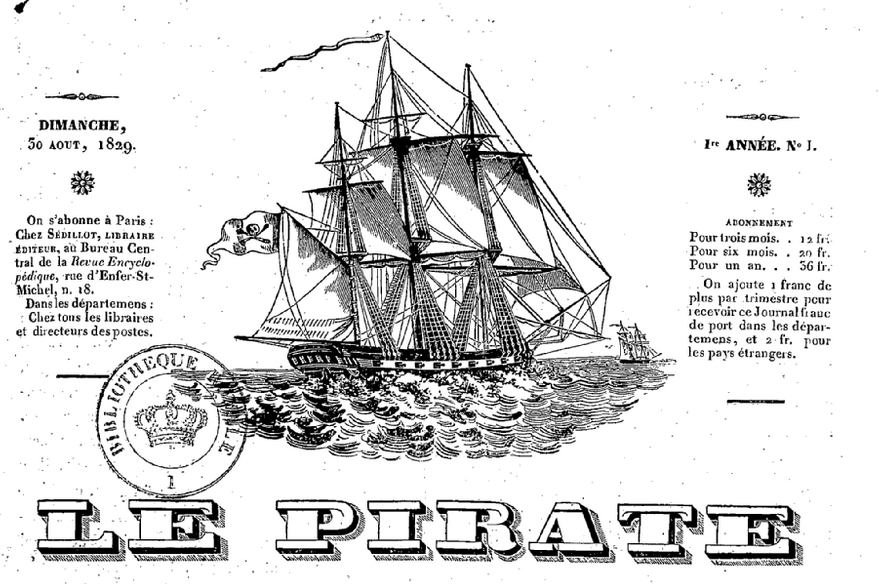
Les revues scientifiques et intellectuelles mettent en œuvre une même réciprocité de la copie que les journaux. Les articles se disséminent sans que l’approbation de l’auteur ne soit nécessaire. Toutes les revues puisant communément dans ce domaine public de facto, et toutes en retirant des avantages, personne n’entreprend de réclamer une forme de propriété littéraire3.
Les exigences de l’écriture scientifiques encouragent la consécration de ce droit de recopie. L’utilisation d’abrégés ou de paraphrase pour rendre compte de telle ou telle publication est toujours risquée : dans un raisonnement systématique, aucun terme n’est employé au hasard, et la substitution d’un mot ou d’une phrase peut faire dévier l’énoncé de son sens originel. On ne peut postuler ici, une distinction claire entre les idées et l’expression : dans des réseaux conceptuels aussi serrés que, par exemple, l’énoncé de la loi de la gravitation, les mots ne constituent pas des effets de styles, que l’on pourrait altérer sans dommage. La littérature scientifique du XIXe scientifique fait ainsi un recours extensif à la longue citation, reprenant fréquemment des pages entières.
Cependant, les revues scientifiques se distinguent sur un point des journaux : elles appliquent une forme de droit moral informel. La citation de l’auteur et l’attribution de ses idées est une préoccupation essentielle. D’après Jean-Claude Guédon, l’une des première revue scientifique moderne, les Philosophical Transactions of the Royal Society, tient lieu de registre public des découvertes scientifiques4 . Si elle comprenait initialement de nombreuses contributions anonymes, la fonction-auteur prend rapidement le dessus : en dix ans, la plupart des articles sont systématiquement signés et attribués.
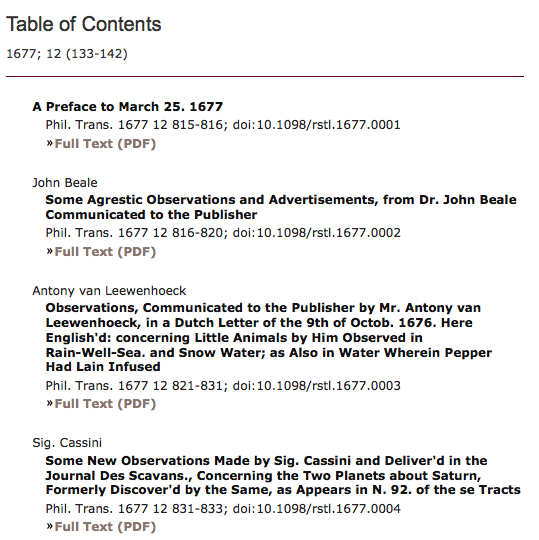
Afin de préserver ces pratiques textuelles, les milieux scientifiques se mobilisent ponctuellement contre une extension “excessive” de la propriété littéraire. Au Royaume-Uni, certains éditeurs n’étaient pas satisfaits des dispositions du Statut de la Reine Anne de 1710 (qui prévoit un droit de copie de 14 ans renouvelable une fois). Ils invoquent la préexistence d’une loi commune (common law), qui justifierait l’établissement d’une propriété littéraire perpétuelle. Les monopoles préexistants au statut pouvaient en effet s’attacher à des publications parfois anciennes (il était tout à fait envisageable de réclamer un privilège pour toutes les éditions à venir de Platon, par exemple). En 1774, un éditeur écossais, Alexander Donaldson, fait l’objet d’un procès pour avoir republié un texte dans le domaine public. Les intellectuels des Lumières écossaises (David Hume, Adam Smith…) soutiennent Donaldson au nom de la défense de la circulation des idées. Adam Smith est consulté au procès ; il met en évidence les dangers d’une propriété perpétuelle sur les arts et les sciences5 . Dans un passage de la Richesse des nations, le grand théoricien du capitalisme moderne range le droit d’auteur parmi les monopoles potentiellement nuisibles6.
Un monopole temporaire de ce genre peut être justifié par les mêmes principes qui font qu’on accorde un semblable monopole à l’inventeur d’une machine nouvelle, et celui d’un livre nouveau à son auteur. Mais, à l’expiration du terme, le monopole doit certainement être supprimé7.
À la chambre des Lords, Lord Camden dénonce l’effet pernicieux d’une propriété littéraire perpétuelle sur la diffusion des connaissances : “ Le savoir et les sciences ne doivent pas être enchaînés à une telle toile d’araignée”8 . Finalement le procès Donaldson v. Beckett conclut au caractère inappropriable du domaine public.
Face à la persistance du droit de recopie au sein des publications périodiques, la jurisprudence est bien embarrassée. Je n’ai pas encore retrouvé de jugements impliquant une revue scientifique aux XVIIIe ou au XIXe siècle, mais s’agissant des journaux, l’invocation de la propriété littéraire est éludée. Ainsi dans un procès de 1836 opposant le journal l’Estafette à plusieurs quotidiens, la Cour royale (l’ancêtre de notre cour d’appel) ne reconnaît qu’une atteinte à l’activité commerciale des plaignants, en raison d’emprunts réguliers et excessifs :
Considérant que celui qui reproduit dans son journal les articles d’autres journaux, et notamment les articles dits de fond, politiques ou littéraires, porte préjudice aux propriétaires desdits journaux ; Que le préjudice est d’autant plus grave que la reproduction est plus fréquente, et aussi plus rapprochée de l’époque à laquelle les articles ont été reproduits ont été publiés dans les journaux auxquels ils sont empruntés.
Les revues sous licence libre (1852-1908)
Ce domaine public de facto pouvait-il perdurer longtemps ? La codification progressive d’un droit d’auteur international incite les législations à lever ces ambiguïtés et à sécuriser le statut des périodiques, sans attenter aux pratiques propres aux cultures textuelles journalistiques et scientifiques.
Le traité bilatéral entre la France et l’Angleterre de 1852 (qui servira d’inspiration à la plupart des traités bilatéraux conclus entre les pays européens au cours de la seconde moitié du XIXe siècle) comporte une disposition spécifique pour les journaux et les recueils périodiques (art. 9).
Nonobstant les dispositions contenues dans l’acte sur le droit international de propriété littéraire, ou celles du présent acte, tout article politique publié à l’étranger, dans un journal ou dans une revue périodique, pourra être réimprimé ou traduit en Angleterre dans tout journal ou revue périodique, pourvu qu’on indique la source d’où il est tiré ; et tout article traitant d’un autre sujet et publié comme il vient d’être dit pourrait aussi être réimprimé et traduit pourvu qu’on en indique la source, à moins, toutefois, que l’auteur n’ait formellement déclaré qu’il s’en réservait la propriété, ainsi que le droit de traduction, et cela en un endroit apparent du journal ou de la revue périodique ou l’article a été publié pour la première fois
Dans ce nouveau cadre légal, la situation est totalement inversée par rapport aux usages qui prévalent aujourd’hui. Tous les articles des revues périodiques (et, donc, des revues scientifiques) sont, par défaut, sous une forme de licence libre : tout-le-monde peut les reproduire sous réserve de les citer correctement (donc, dans le respect du droit moral traditionnel des communautés scientifiques). L’auteur ou l’éditeur doivent explicitement déclarer que leur publication est sous le régime du droit d’auteur pour empêcher la réutilisation. Or, actuellement, c’est le droit d’auteur qui prime et l’auteur doit expressément signaler qu’il autorise la réutilisation (sous une licence creative commons, par exemple).
Ce serait intéressant de mener une enquête sur le développement de mentions légales de type “tout droits réservés” dans les revues scientifiques parues de 1852 à 1908. Je ne mentionnerai ici qu’un exemple éloquent : celui du Journal des Économistes. Il s’agit d’une revue prestigieuse qui est très bien familiarisée avec les débats sur le droit d’auteur. Certains de ses contributeurs réguliers militent non seulement pour une application maximaliste mais pour la mise en place d’une propriété intellectuelle perpétuelle. Dans les exemplaires répertoriés par Gallica, de 1842 à 1936, je ne vois aucune mention légale réservant la réutilisation (même si, de fait, la propriété littéraire est appliquée après 1908).
Les premières grandes conventions internationales du droit d’auteur ne remettent pas en cause cette exception. La convention de Berne de 1886 prévoit ainsi que
Les articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l’un des pays de l’Union peuvent être reproduits, en original ou en traduction, dans les autres pays de l’Union, à moins que les auteurs ou éditeurs ne l’aient expressément interdit. Pour les recueils, il peut suffire que l’interdiction soit faite d’une manière générale en tête de chaque numéro de recueil. En aucun cas, cette interdiction ne peut s’appliquer aux articles de discussion politique ou à la reproduction de nouvelles du jour ou des faits divers (art. 7).
La convention met en œuvre trois régimes distincts, qui correspondent aux usages propres de trois cultures textuelles. Les publications ne s’apparentant pas à des périodiques intègrent le régime général du droit d’auteur. La plupart des articles journalistiques (discussion politique, nouvelles, faits divers) restent dans un domaine public de facto, sans sans qu’il soit nécessaire de citer la source originelle (et sans que ces auteurs ou éditeurs ne puissent empêcher la reprise des textes). Enfin, les revues périodiques (et, ipso facto, les revues scientifiques) sont couvertes par une licence libre par défaut.
Sous le régime du droit d’auteur (1908-…)
Ce consensus, plutôt satisfaisant, a tenu vingt ans. En 1908, la conférence de Berlin met un terme définitif à la licence libre et limite le champ des exceptions aux seules publications journalistiques

L’art. 9 affirme ainsi que “les romans-feuilleton, les nouvelles et toutes autres œuvres soit littéraires, soit scientifiques, soit artistiques, quel qu’en soit l’objet, publiés dans les journaux ou recueils périodiques des pays de l’Union, ne peuvent être reproduits dans les autres pays sans le consentement des auteurs”. La réutilisation sans consentement n’est réservé qu’aux cas suivants : “À l’exclusion des romans-feuilletons et des nouvelles tout article de journal peut être reproduit par un autre journal si la reproduction n’en est pas expressément interdite”. La mention des autres recueils périodiques saute complètement. Tout en regrettant que les exception journalistiques demeurent, le syndicat pour la protection de la propriété intellectuelle se félicite de ce changement majeur :
Il y a lieu, toutefois, de remarquer que le mot recueil ne se retrouvant pas reproduit dans le second paragraphe, le principe posé dans le premier s’appliquerait tout au moins d’une façon complète aux recueils9 .
Un rapport de la commission parlementaire française apporte quelques éléments contextuels. La France et l’Allemagne militent pour une restriction, voire une abolition, du régime particulier des publications périodiques — les autres pays de l’union souhaitent par contre la maintenir10 . La commission ne nourrissait pas beaucoup d’espoirs à ce propos :
Il est douteux que, dans cet ordre d’idées, la prochaine Conférence de Berlin consente à réaliser l’assimilation absolue, au point de vue de la protection, des articles de journaux aux autres productions du domaine littéraire, sans aucune mention de réserve. Trop de législations sont encore hostiles à ce point de vue pour qu’on puisse espérer vaincre les résistances qui ne manqueront pas de se produire (p. 17).
Or, si les membres de la commission s’accordent à mettre un terme à l’exception périodique, les principaux intéressés y sont beaucoup moins favorables. Le rapport mentionne ainsi que les Congrès internationaux des association de presse font prévaloir le principe d’un droit de recopie des articles politiques. Les agences de presse, auditionnées pour l’occasion, n’y voient pas grand intérêt : elle n’en retireraient qu’une “satisfaction platonique” et souhaitent plutôt se placer sur le terrain de l’opposition à la concurrence déloyale (soit, dans la droite ligne de la jurisprudence française depuis les années 1830. Les revues périodiques, a fortiori scientifiques, n’ont été mentionnées à aucun moment.
Leur exclusion du champ de l’exception semble avoir été initialement évoqué par la délégation belge pendant les séances de la conférence (consignées dans un épais volume, mis en ligne par l’OMPI). Son représentant défend d’abord la reprise des articles journalistiques, notamment par les petites feuilles locales, sans nécessairement mentionner la source. Puis, il remarque en passant que le maintient de la licence libre ne se justifie en aucun cas pour les revues périodiques :
Mais si la restriction se justifie lorsqu’il s’agit de reproduction de journal à journal, en est-il encore de même lorsqu’il s’agit de recueils périodiques ? Il nous est impossible de l’admettre. Aucune des raisons professionnelles qui font que le journaliste demande la présomption de son consentement à la reproduction de ses articles de journaux, à défaut de réserve, ne s’applique aux articles de recueils périodiques. D’autre part, on chercherait en vain un motif juridique quelconque qui autorise à réglementer diftéremment le droit d’auteur sur une œuvre littéraire d’après qu’elle aura été publiée ou isolément ou dans un recueil périodique11.
J’ai l’impression que la disparition de la licence libre pour les revues périodiques correspond à une concession calculée. Tandis que les allemands et français étaient prêts à normaliser le statut des publications journalistiques, les petits pays européens tenaient à maintenir un droit de recopie pour alimenter leur presse en articles dérivés. Ces derniers ont finalement préféré lâcher du lest sur le front des revues périodiques, afin d’être en meilleure position pour maintenir des exceptions journalistiques.
Les revues scientifiques et littéraires ne semblent pas avoir soupçonné l’issue du débat. Une analyse de Louis Delzons, publiée dans la Revue des deux mondes considère ainsi que la nouvelle formulation de la convention de Berlin ne change rien à leurs usages12.
Le raisonnement est faux en théorie (il n’y a pas de doute que les revues périodiques sont désormais exclues du champ des exceptions), mais il tient sans doute en pratique. Déjà, la convention de Berlin n’est pas adoptée par tout-le-monde (plusieurs signataires des précédentes conventions de Berne et de Paris n’en tiennent pas compte). Et, les lois ne sont appliquées que dans la mesure où elles sont appliquées : les usages et régulations informelles des communautés scientifiques restent en place quelques temps.
Il est difficile de retracer le processus d’imposition du droit d’auteur dans le champ scientifique — en partie parce que la plupart des textes permettant de le documenter restent couverts par le droit d’auteur et sont rarement accessibles en ligne. Je suppose que l’apparition des grands éditeurs scientifiques, à partir des années 1950 et 1960 (c’est à peu près l’époque du décollage d’Elsevier), a grandement contribué à accélérer le mouvement. Le modèle économique de ces industries académiques repose explicitement sur l’interdiction du droit de recopie (si un périodique pouvait compiler, par exemple, les meilleurs articles des revues d’Elsevier, leur monopole disparaîtrait complètement). Tout ce chapitre reste à écrire…
En dépit de ce contexte défavorable, la licence libre de 1852 semble se perpétuer jusqu’à aujourd’hui dans les pratiques. En janvier dernier, j’intervenais à une conférence de l’Université de Rennes-2 sur le droit d’auteur scientifique. Pendant la table ronde, Hervé Régnauld témoignait que les géographes continuent d’appliquer un droit de recopie pour les cartes : la mention de la source suffit généralement sans qu’il ne soit nécessaire de contacter systématiquement l’auteur.
Le mouvement open access tient ainsi autant d’une révolution que d’une renaissance. Alors que le droit de recopie était en train de dépérir, l’apparition de nouveaux supports de diffusion et la codification des licences Creative Commons se conjuguent pour lui donner une seconde vie et restaurer des formes de régulations mieux adaptées à la diffusion de la recherche scientifique.
- Voir mon article à paraître dans la revue Communications et langages : “L’industrie des auteurs : éléments d’une théorie critique de la propriété musicale“
- Renouard, Traité du droit d’auteur dans la littérature, t. II, Paris : Paul Renouard, 1839, p. 114-115
- Je n’ai pour l’instant identifié aucun cas de jurisprudence concernant une revue scientifique au XIXe siècle dans la base de données très complète Primary Sources in Copyright — il y a bien Abernethy vs. Hutchinson qui implique une revue célébrissime, The Lancet, mais, faute de preuve, le juge a renoncé à trancher
- Jean-Claude Guédon, In Oldenburg’s Long Shadow, Washington, 2001, p. 8 et sq
- Mike Hill & Warren, The Other Adam Smith, Stanford University Press, 2014, p. 87
- Ironiquement, Adam Smith est fréquemment invoqué pour justifier la généralisation des règles de propriété intellectuelles, voire leur allongement à perpétuité
- Adam Smith, Recherches sur la nature et la cause de la richesse des nations, Paris : Blanqui, 1843, p. 414
- Ronan Deazley, Rethinking copyright : history, theory, language, Edward Elgar Publishing, 2006, p. 19
- Révision de la convention de Berne, examen du texte voté par la conférence de Berlin, Rapport présenté au Syndication pour la protection de la propriété intellectuelle, Paris : Dumoulin, 1910, p. 15
- Les journaux de petits pays se nourrissaient en effet très largement de la reprise de nouvelles publiées à l’étranger. Guillaume Pinson évoque ainsi l’émergence d’une culture journalistique francophone à partir de la reprise des rubriques et articles de la presse parisienne en Belgique, en Suisse et en Amérique du nord
- Actes de la Conférence réunie à Berlin, Berne : Bureau International de l’Association littéraire et artistique, 1910, p. 205-206
- Louis Delzon, “L’œuvre de la conférence de Berlin que la protection littéraire et artistique“, Revue des deux mondes, décembre 1908, p. 902





